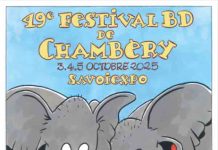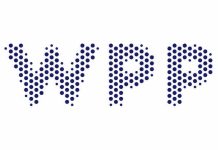Micheline Presle, l’une des actrices françaises les plus populaires des années 40, décédée ce mercredi à l’âge de 101 ans, a su alterner rôles légers et dramatiques. Voici cinq des principales oeuvres dans lesquelles elle a tourné.
– La nuit fantastique (1942) : Dans ce film réalisé par Marcel L’Herbier sous l’Occupation, Micheline Presle forme le couple idéal avec Fernand Gravey. Elle incarne une mystérieuse femme habillée en blanc dont rêve toutes les nuits Denis. Obnubilé par ce fantasme, il se détourne de sa compagne et suit cette image, emporté dans un univers onirique. Elle incarne une nouvelle génération d’actrices.
– Boule de suif (1945) : Dans ce film de Christian-Jaque, qui adapte la nouvelle du même nom de Guy de Maupassant, elle remplace Viviane Romance qui refuse d’incarner «une putain patriotique». Le réalisateur enverra Micheline Presle dans les Pyrénées pour prendre du poids pour le rôle. Elle joue ainsi une prostituée au grand coeur qui sauve, pendant l’occupation prussienne en 1870, les passagers d’une diligence. Elle n’en tirera que du mépris pour tout remerciement. Le film lance véritablement sa carrière.
– Le diable au corps (1947) : C’est elle qui choisit Gérard Philipe comme partenaire dans cette adaptation du roman de Raymond Radiguet. Les deux stars jouent les amours d’un lycéen et d’une infirmière, jeune mariée à un soldat pendant la Première Guerre mondiale. L’adaptation en noir et blanc et en Scope par Claude Autant-Lara fait scandale pour incitation «à l’exaltation de l’adultère» et à l’antimilitarisme, avant de devenir un classique. «On aime les personnages, on aime qu’ils s’aiment, on déteste avec eux la guerre et l’acharnement public contre le bonheur», avait défendu Jean Cocteau. Micheline Presle est sacrée meilleure actrice aux Victoires du cinéma français, ancêtres des César. Elle reconnaîtra des années plus tard être tombée amoureuse de Gérard Philipe pendant le tournage.
– La Religieuse (1967) : L’actrice, oubliée après quasiment dix ans aux Etats-Unis, va connaître un nouveau rebond avec la Nouvelle Vague. Après un grand succès sur les planches dans «Qui a peur de Virginia Woolf?», elle se fait repérer par Jacques Rivette avec qui elle tourne «La Religieuse», adapté du roman épistolaire de Diderot. Elle incarne la supérieure d’une jeune novice (Anna Karina), contrainte de prendre le voile. Le film est censuré en 1966, accusé de «heurter gravement les sentiments et les consciences d’une très large partie de la population». Il sort finalement en 1967 dans cinq salles à Paris, interdit aux moins de 18 ans, ce qui consacre son succès.
– «Les Saintes Chéries» (1965-1971) : La série télévisée en 39 épisodes, diffusée dès 1965 sur la première chaîne de l’ORTF, se présente comme l’idéal souriant de la France d’avant-mai 68, en noir et blanc puis en couleur. Ecrite par Nicole de Buron, cette étude de moeurs pleine d’humour présentait, par le détail, un quotidien aisément identifiable par chaque Français ou presque. La série devint la star des samedis soirs et les époux Lagarde (Daniel Gélin et Micheline Presle) le symbole des Français moyens, au coeur des Trente glorieuses.