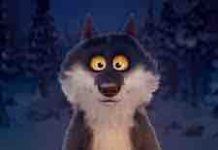Entre révolution du délinéaire, polar revisité, fictions sociétales et comédies audacieuses, Anne Holmes, directrice des programmes de France Télévisions, trace la feuille de route de la fiction française sur France 2, France 3 et France.tv, qu’elle veut imposer comme “la première chaîne” du groupe.
Le bilan l’an dernier a été globalement stable, et le début de saison également sur France 2 et France 3. Quelle tendance retenez-vous aujourd’hui dans la consommation de fiction entre le linéaire et France.tv ?
C’est ma grande révélation de l’année. Nous avons appris beaucoup avec «L’Éclipse», puis avec «Rivages», et cela s’est confirmé avec «Made in France» : parfois, le délinéaire peut être plus fort que le linéaire. Cela change tout : nous ne raisonnons plus en termes de «fiction du mercredi» ou «fiction du vendredi». Nous ne pensons plus en logique de rendez-vous fixes, mais en logique d’appétence : le téléspectateur choisit sa série parce qu’il en a envie, pas parce qu’elle est programmée un soir précis. C’est une révolution de paradigme.
C’est donc un vrai changement de logique dans vos choix éditoriaux ?
Absolument. C’est une liberté beaucoup plus grande. Nous ne sommes plus obligés de construire des cliffhangers pour que le public revienne «mercredi prochain». Soit il visionne la suite tout de suite, soit il ne le fait pas. Cela simplifie beaucoup les choses.
Vous insistez sur le rôle central de la plateforme. Quelle place la logique «preview» et «binge» occupe-t-elle désormais dans vos choix d’écriture et de formats ?
Une place essentielle. Pour moi, France.tv est devenue ma première chaîne. Je ne travaille plus seulement pour France 2 ou France 3, mais pour France.tv. La plateforme a un atout majeur : elle rajeunit le public. On disait souvent que la fiction de France Télévisions s’adressait à une audience âgée, avec une moyenne autour de 65 ans. Aujourd’hui, la moyenne d’âge sur France.tv est descendue à 57 ans. Le pari du rajeunissement est réussi.
Votre budget annuel de 280 M€ reste constant, mais les coûts explosent. Comment conciliez-vous ambitions créatives et contraintes économiques croissantes ?
Nous optimisons. Peu de gens le savent, mais depuis des années, le mardi soir sur France 3, nous proposons de la fiction à coûts maîtrisés : environ 500 000 € par épisode, contre 690 000 à 750 000 € normalement. Des séries comme «Tandem», «Face à Face», «Tom et Lola» ou À priori entrent dans cette logique. Résultat : au lieu de coûter 1,5 à 1,7 M€, la soirée revient à 1 M€. Avec 12 épisodes, le producteur s’y retrouve par effet d’échelle, et nous réinvestissons l’économie réalisée dans d’autres projets, y compris des fictions en costumes.
Pourquoi cette logique n’a-t-elle pas été appliquée plus tôt ?
En réalité, je l’ai mise en place dès «Tandem», il y a dix ans. Mais il existait un certain snobisme autour des fictions à coûts maîtrisés Aujourd’hui, c’est devenu monnaie courante. Les producteurs y trouvent leur compte : ils gagnent de l’argent, ont du volume, et nous, nous pouvons enrichir notre catalogue avec des rediffusions. L’équilibre se fait ainsi.
Comment renouvelez-vous l’offre policière ?
Nous avons expérimenté plusieurs pistes. Après l’ère des grands héros «à la Navarro», nous avons mis en avant beaucoup de femmes : «Astrid et Raphaëlle», «Tropiques Criminels», etc. Aujourd’hui, je crois davantage aux logiques de groupe. En période de crise, «la famille qu’on choisit» est plus forte que «la famille qu’on subit». Les séries de groupes, comme «Les Invisibles», permettent de multiplier intrigues et personnages. Cela nourrit les rebondissements et donne plus de richesse à l’écriture.
Quelle stratégie poursuivez-vous autour du patrimoine littéraire ?
C’est un pilier du service public. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera. Nous avons déjà adapté Jean-Jacques Rousseau, «La Peste» ou encore mis en avant des figures comme Olympe de Gouges. Ces œuvres font systématiquement autour de 3,5 millions de téléspectateurs, ce qui est excellent pour ce genre. Nous cherchons toujours à faire résonner le patrimoine avec notre époque. «Verlaine-Rimbaud», par exemple, trouve un écho évident dans le contexte actuel de montée de l’homophobie. «Le Rouge et le Noir», c’est l’histoire de l’ascension à tout prix : un thème plus que jamais d’actualité.
Les comédies et les héros disjonctés sont une de vos priorités. Comment créer des marques fortes dans un genre fragile sur le service public ?
En s’acharnant (rires). C’est le plus difficile. Les gens disent qu’il manque de comédies, mais ils n’y vont pas spontanément. La comédie reste le terrain privilégié du cinéma, avec dix longs-métrages par an portés par de grands castings qui, souvent, cartonnent à la télévision. Nous allons tenter des choses, comme «Bête de flic», un policier qui entend les voix des animaux. C’est risqué, mais notre mission est d’innover. L’avantage du service public, c’est que nous ne dépendons pas directement de la publicité : nous pouvons expérimenter et proposer des œuvres différentes.
France Télévisions multiplie aussi les fictions ancrées dans le réel…
C’est le rôle du service public : refléter la société et montrer le monde. «Triple Peine» revient sur le premier #MeToo en France, celui de Noémie Kocher. Avant cela, nous avions déjà traité du viol avec «La Consolation», adaptée du livre de Flavie Flament, bien avant l’affaire Weinstein. L’actualité va vite, et c’est un pari risqué. Une fiction prend 18 mois à se fabriquer. Il arrive que nous ayons raison trop tôt, ce qui peut nous desservir. «Dans l’ombre», par exemple, a été percutée par la dissolution de l’Assemblée. Mais il faut tenter.
De plus en plus de personnalités issues d’autres univers rejoignent vos castings. Jusqu’où souhaitez-vous développer cette logique d’incarnation grand public ?
C’est une logique ponctuelle, presque un clin d’œil. Quand nous confions un rôle à Jean-Pierre Foucault, Michel Cymes, Stéphane Bern ou bientôt Patrick Sabatier, c’est un cadeau aux téléspectateurs. Ce sont des figures qu’ils aiment, et cela amuse aussi les intéressés. En revanche, cela ne veut pas dire que nous allons multiplier les héros récurrents incarnés par des animateurs. Ce n’est pas notre objectif.
TF1 a ouvert la voie aux coproductions avec Netflix. France Télévisions est-il prêt à franchir un pas supplémentaire ?
Nous n’avons jamais été fermés. Nous avons déjà coproduit avec Amazon, et nous restons ouverts, tant que cela correspond à notre ligne éditoriale. Plus il y a de financements, plus on peut produire des séries ambitieuses. Mais il n’y a pas, à ce stade, de projet identifié avec Netflix ou d’autres plateformes.