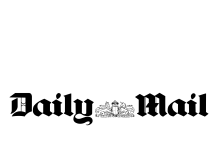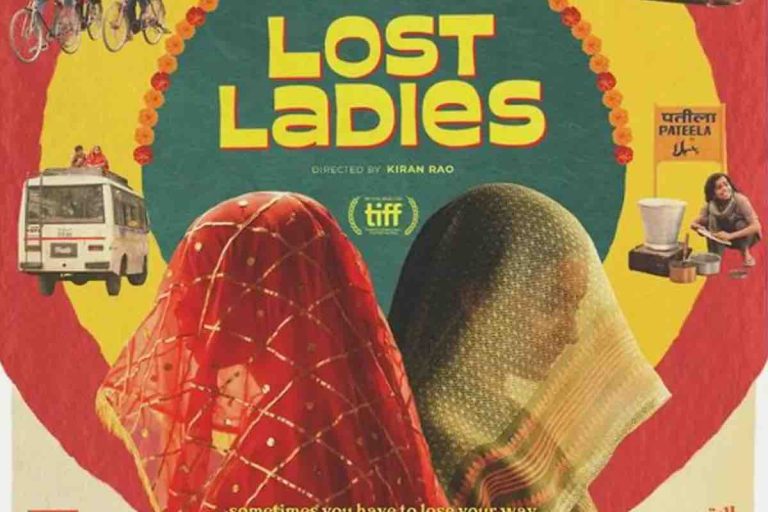
Et si le changement était en marche? En marge d’une industrie de Bollywood aussi conservatrice que masculine, une nouvelle vague de cinéastes émerge en Inde en proposant des films de femmes plus proches des réalités de leur condition. «La situation évolue», se rejouit la metteuse en scène Reema Kagti. «De plus en plus de femmes écrivent leurs propres scénarios, les tournent. Avec le temps, nous avançons dans une perspective plus saine, plus réelle». Ces derniers mois, plusieurs productions de cette nouvelle veine féministe ont percé l’écran, notamment sur la scène étrangère. Tout en haut de l’affiche, «Laapataa Ladies», de Kiran Rao, a été retenu pour l’Oscars 2025 du meilleur film étranger. Et «All We Imagine as Light», de Payal Kapadia, a été recompensé d’un Grand Prix au dernier festival de Cannes. Lui aussi sorti en 2024, «Mrs.», d’Arati Kadav, décrit les servitudes quotidiennes d’une femme mariée, jusqu’à sa révolte contre son époux. «Il n’y a qu’à lire les réseaux sociaux pour voir que c’est ce que vivent une majorité de femmes en Inde», note la sociologue Lakshmi Lingam. Dans l’abondante production cinématographique indienne – jusqu’à 2.000 films chaque année dans plus de 20 langues différentes – les personnages de femmes ancrées dans la réalité font figure d’exception. «Le cinéma grand public est resté très mâle, les scénarios très misogynes», poursuit Lakshmi Lingam. «Les hommes y jouent les principaux rôles, les femmes les utilités romantiques, belles à regarder, sans participation équivalente». Sans surprise, le vent féministe a commencé à souffler dans le cinéma indépendant. «Depuis les années 1970, des metteurs en scène comme Shyam Benegal montrent des personnages de femmes fortes», qui ne sont pas que des mères ou des objets du désir masculin, rappelle la productrice-réalisatrice Shonali Bose. «Les femmes ont encore du mal à imposer des scénarios reflétant leur réalité», tempère toutefois l’actrice-productrice Dia Mirza. «Mais il y a plus de réalisatrices, de productrices, de scénaristes. Alors les narratifs sont de plus en plus inclusifs». C’est le cas des réalisations de Reema Kagti, qui bousculent les normes sociétales dominantes. Dans sa série policière «Dahaad», saluée pour son authenticité, une jeune «flic» tente de prendre la main sur ses collègues hommes dans une enquête sur des disparitions de femmes en série. «Notre problème n’est pas une question de genre mais plutôt de pouvoir faire ce que nous voulons», note encore Shonali Bose. «Quand on veut faire du cinéma grand public, nous sommes confrontées à un marché de plus en plus conservateur». Réputée pour ses films militants, Konkona Sen Sharma se dit prudemment optimiste. «Il y aura probablement à l’avenir plus de femmes dans le cinéma qu’auparavant», anticipe-t-elle, «mais nous n’avons toujours pas assez de femmes aux postes de pouvoir et de décision». «Ces choses ne vont pas changer du jour au lendemain mais les spectateurs sont exposés à un autre discours ambiant», analyse Lakshmi Lingam, «désormais les femmes sortent, elles s’habillent comme elles veulent…». Selon elle, le mouvement né dans le cinéma indépendant a commencé à gagner les superproductions plus populaires, à l’initiative de réalisatrices au caractère bien trempé. «Stree 2», un film d’horreur en mode burlesque avec la vedette «bollywoodienne» Shraddha Kapoor, a raflé à la très mâle superstar Shah Rukh Khan la 1ère place du box-office 2024. Mais le mouvement reste très lent. L’an dernier, 15% des films indiens affichaient à leur générique des noms de productrices exécutives, contre 10% deux ans plus tôt, selon le O Womaniya Report, qui recense la place des femmes dans le secteur du divertissement. «Les femmes scénaristes ont d’excellentes idées mais ne sont pas soutenues par les producteurs», constate Lakshmi Lingam. «Finalement, c’est l’argent qui détermine les films qui sont réalisés et ceux qui ne le sont pas», insiste la sociologue.