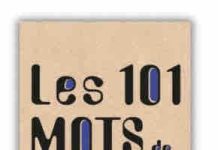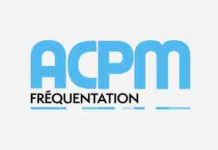Les ministres européens de la Justice ont lancé vendredi dernier à Lille des discussions pour inclure les crimes et discours de haine, notamment en ligne, dans les infractions de l’UE, afin de faire converger leur réponse pénale. Si aucun pays n’a complètement fermé la porte à cette proposition qui requiert l’unanimité des Vingt-Sept, l’Allemagne a fait part de la nécessité de consulter d’abord son parlement, tandis que certains Etats membres ont soulevé la question du respect de la liberté d’expression.
La lutte contre les discours de haine est l’une des priorités de la présidence française semestrielle du Conseil de l’UE. «Il faudra que nous travaillions encore mais je ne désespère pas que les choses évoluent dans un sens très favorable» d’ici la prochaine réunion de mars, a commenté le ministre français de la Justice Eric Dupond-Moretti à l’issue de ces 1ères discussions. La liste des «eurocrimes» (article 83 du Traité sur le fonctionnement de l’UE) regroupe dix infractions considérées comme «particulièrement graves», comme le terrorisme, la traite des être humains, l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, les trafics d’arme et de drogue. «C’est un choix politique que de dire que l’on ne peut plus vivre avec cette haine permanente qui se diffuse et a des effets parfois létaux», a poursuivi le garde des Sceaux, évoquant l’assassinat de l’enseignant Samuel Paty en octobre 2020. La Commission a proposé en décembre d’étendre la liste des infractions de l’UE aux discours et crimes de haine, s’inquiétant de «leur forte et soudaine progression en Europe». «On voit que des discours contre les femmes, les minorités et toute une série de personnes se développent très fortement», a commenté le commissaire européen à la Justice, Didier Reynders. Cette reconnaissance permettrait ensuite «une harmonisation d’un certain nombre de règles en matière pénale». La Pologne a appelé, avant tout changement, à faire une «analyse complète des possibilités existantes» contre les discours de haine.
Les ministres se sont aussi entretenus avec des représentants de Facebook/Meta et Google à propos de leur coopération en matière judiciaire. Un projet de règlement européen sur la preuve électronique (e-evidence), bloqué depuis quatre ans, oblige les plateformes à désigner un représentant dans l’Union, et à répondre dans un délai de dix jours -quelques heures en cas d’urgence- à une demande d’accès à des preuves de la part d’une autorité judiciaire. M. Dupond-Moretti a regretté l’absence de Twitter, mais s’est félicité de la «bonne volonté» exprimée par les responsables présents, Kent Walker (Google) et Markus Reinisch (Facebook/Meta), qui «appellent de leur voeux un cadre légal», a-t-il dit. Il a espéré une avancée de «ce texte attendu par les magistrats et par les plateformes». Les plateformes font par ailleurs l’objet d’un projet de règlement européen sur les Services numériques (DSA), qui doit permettre de bannir les contenus illégaux. Une législation qui s’appliquera notamment à la messagerie cryptée Telegram, actuellement sur la sellette en Allemagne, pour les propos haineux allant jusqu’aux menaces de mort à l’égard de personnalités politiques, publiés dans des groupes d’opposants aux restrictions sanitaires. Présent à Lille, le ministre allemand de la Justice Marco Buschmann a appelé Telegram à «appliquer» la législation allemande, faute de quoi la messagerie pourrait se voir infliger une amende de «plusieurs millions d’euros».