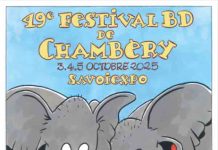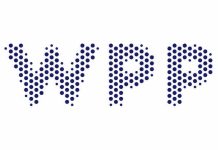Quand les bistouris crèvent les écrans: Noah Wyle, révélé par «Urgences» il y a trente ans, revient dans «The Pitt», nouvelle série en milieu hospitalier, genre à succès toujours fécond. Retour sur quelques incontournables:
«The Pitt», dernier né de la mère porteuse «Urgences» : «On est dans la merde», «Ils sont 52 en salle d’attente et il n’est même pas 7H00 du matin», «Allons sauver des vies»: ces dialogues de «The Pitt», nouvelle série de Max diffusée à partir de vendredi, rappelleront aux plus anciens ou aux jeunes curieux l’effervescence d’»Urgences», au nom évocateur, apparue en 1994. Cette matrice a poussé plus loin le réalisme esquissé par «Hôpital St Elsewhere» (dès 1982), avec un collectif empathique dans l’essoreuse. Ce qui n’exclut pas de belles individualités, comme le Dr Ross incarné par un débutant nommé George Clooney. «Urgences» a fait école, de «Grey’s anatomy» (2005) à «Chicago Med» (2015). Autre révélation d’»Urgences», Noah Wyle – qui n’a cependant pas connu la même carrière stratosphérique que Clooney – assure donc le passage de témoin avec «The Pitt». Loin de la cravate sous la blouse du jeune premier glabre d’«Urgences», ce nouveau personnage arbore barbe et sweat à capuche couvrant le stéthoscope. A lui d’encadrer la relève aux urgences de Pittsburgh, ville américaine qui résonne avec le titre.
«Dr House», «Watson», détectives du diagnostic : «Tumeur cérébrale, elle est foutue, aucun intérêt»: «Dr House» décape avec un médecin imbuvable et toxicomane. Derrière les saillies cyniques se cache un fin limier du métabolisme qui finit par trouver le diagnostic invisible au scanner. Ce personnage acide et cassé par l’existence – claudiquant, appuyé sur une canne -, incarné par Hugh Laurie à partir de 2004, n’en finit pas de faire des émules. «Est-ce que tu couchais avec moi pour mes drogues ?», demande ainsi son amant à «Nurse Jackie», infirmière des urgences accro aux béquilles chimiques jouée par Edie Falco à partir de 2009. Voilà pour la facette dépendance ombrageuse empruntée à «Dr House». Pour le versant atypique, on peut citer le chirurgien atteint d’un syndrome autistique de «Good Doctor» (2017). Et puisque le «Dr House» a souvent été comparé à Sherlock Holmes, la série «Watson», bientôt sur CBS, boucle la boucle. Soit, dans le monde d’aujourd’hui, les aventures du docteur John Watson, alors que le célèbre détective a disparu. Ce héros pousse ses collaborateurs à sortir de la clinique pour comprendre des pathologies rares.
«M.A.S.H.», «Hippocrate», du film à la série chirurgicale : Choisir une chanson comme «Suicide is painless» («Le suicide est sans douleur») pour une fiction autour de chirurgiens annonce la couleur, tirant vers le noir. Cette mélodie berce le film «M.A.S.H», réalisé par Robert Altman et récompensé par la Palme d’or du Festival de Cannes en 1970. Long métrage décliné en série dès 1972. Derrière l’humour doux-amer, la vie d’une unité médicale américaine pendant la guerre de Corée permet d’évoquer celle du Vietnam, d’actualité au début de la diffusion, et de faire passer des messages anti-militaristes. L’ultime épisode réunit 106 millions de téléspectateurs en 1983, un record. Au milieu de toutes ces productions américaines, un projet français se distingue: «Hippocrate». C’est d’abord un film (2014) réalisé par Thomas Lilti, lui-même médecin, puis une série à partir de 2018. Là aussi, le sous-texte est important, notamment dans la saison 3 diffusée à partir de 2024, avec des médecins confrontés aux conditions de travail dégradées dans l’hôpital public en France.