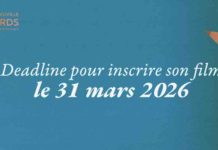Trois minutes, pas une de plus… C’est le temps dont ont disposé les cinéastes en lice pour le 17ème Festival international du film «très court» qui rend hommage à l’art de la concision sur grand écran. «La production de films très courts est née il y a une vingtaine d’années, au moment où les petites caméras digitales ont commencé à être vendues en grandes surfaces», explique Marc Bati, le créateur du «Très court festival» qui se déroule du 5 au 14 juin en France et à l’étranger. «Les productions ont commencé à foisonner avec de la créativité, de l’enthousiasme mais pas de lieux pour les montrer, les festivals traditionnels n’acceptant pas les formats aussi courts et les plateformes d’échanges de vidéos sur internet n’ayant pas encore vu le jour». Bref, il y avait une opportunité à saisir, et un espace d’expression à trouver pour tous ces cinéastes du laconisme.
La 1ère édition du «Très court festival» voit le jour en 1999. Une seule soirée, au Forum des images à Paris, et un succès immédiat. «On pensait ne faire qu’une édition mais on a très vite été débordés par l’affluence», raconte Marc Bati, qui se souvient que des artistes comme Vincent Cassel ou Audrey Toutou ont été vus, à leurs débuts, sur les écrans du festival. Des cinéastes aussi y ont fait leurs premières armes comme Kim Chapiron («Sheitan») ou Delphine Gleize («Carnages»). Dix-sept éditions plus tard, l’événement a pris une dimension internationale avec une centaine de villes participantes, dont 23 à l’étranger. A Paris, il se déroulera les 12, 13 et 14 juin. C’est la réalisatrice Pascale Ferran qui présidera le jury. Plus de deux mille films venus du monde entier ont été visionnés, cette année, par le comité de sélection. Et près de 150 ont été retenus, qui seront répartis dans trois compétitions et quatre sélections thématiques. A l’issue des projections, neuf prix sont décernés, dont le prix du public. Parmi eux, «Je suis Wilson», du Français Thomas Scohy raconte (en à peine plus de 2 mn) l’histoire d’un jeune homme qui ne sait pas choisir… «L’avantage d’un film très court, c’est qu’on peut le revoir plusieurs fois de suite si on n’a pas compris…sans que cela prenne des heures», plaisante Thomas Scohy. «Le format permet d’expérimenter des idées, de tester des concepts sans trop se faire mal financièrement», explique cet ancien ingénieur de 32 ans, fan de Wes Anderson. Le réalisateur dit avoir «truffé» son film de références au cinéaste américain. Après une dizaine de films courts, aux budgets plus que modestes – 5.000 euros pour le dernier – le jeune homme de 32 ans espère franchir un nouvelle étape avec la société de production qu’il vient de créer. Objectif: réunir les 50.000 euros nécessaires à la réalisation de son prochain court métrage, «grâce à une possible coproduction et aux aides du CNC».
En compétition dans la catégorie «Paroles de femmes», avec «Carte postale: Bordeaux», Samien Meridja aborde de façon originale le problème de la prostitution à travers l’expérience d’une jeune fille arrivée dans la capitale girondine. «Le format oblige à aller à l’essentiel, sans tergiverser», explique le cinéaste de 31 ans. Pour lui, «le très court métrage est une forme d’expression en soi, différente du court métrage classique qui constitue un marchepied vers le long métrage». Les chaînes de télévision ne s’y sont pas trompées en réservant de plus en plus d’espace sur leurs antennes aux histoires courtes, souvent à vocation humoristique, comme «Un gars, une fille», «Bref» (sur Canal +) ou «Caméra Café». C’est un format qui colle avec son époque, où il faut aller vite, avoir des idées originales et savoir les exprimer rapidement», explique Marc Bati.