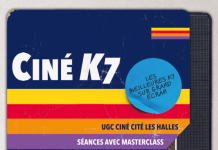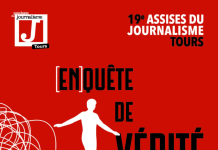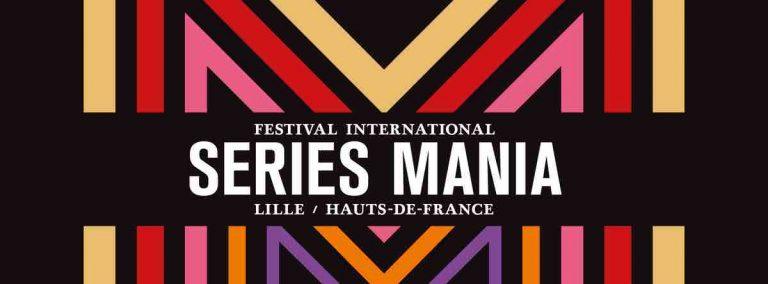
Les séries du ramadan, produites pour ce mois de jeûne, sont une institution dans les pays musulmans, notamment en Algérie dont les productions, plus engagées sur les sujets de société, ont été mises à l’honneur au festival français Séries Mania. Drames sentimentaux, comédies familiales, thrillers haletants… Ces feuilletons quotidiens fleurissent sur les chaînes et sur YouTube pour accompagner les familles après l’iftar, la rupture du jeûne au coucher du soleil. «C’est un rendez-vous incontournable parce que c’est le moment où on partage des histoires» et «où la famille se réunit», a expliqué l’actrice algérienne Zahra Harkat, lors d’une conférence. «En France ou en Europe, il y a des séries et films de Noël, il y a un esprit un peu joyeux, convivial… C’est un peu ce type d’esprit qu’on retrouve pendant le ramadan», a-t-elle ajouté. Cette tradition a aussi des adeptes dans l’Hexagone. Installée dans le sud de la France, Malika, 31 ans, née en France de parents algériens, revient à Lille chaque année pour passer le ramadan avec sa mère et sa fratrie… et regarder ces séries. «C’est un peu institutionnel chez nous», raconte cette comédienne, qui a pu «apprendre plein de mots d’arabe» grâce aux séries algériennes. Cette année, Malika suit «Al Ard» qui porte un message politique sur la colonisation française et les terres agricoles. Auparavant, elle a été marquée par «Babour Ellouh» («bateau de bois»), sur l’émigration clandestine. «Les séries du ramadan existent depuis très longtemps en Algérie mais il y a eu une évolution technique et dans les thématiques traitées ces dix dernières années», explique Zahra Harkat, vue notamment dans une série parlant de corruption. Une évolution favorisée par l’arrivée de chaînes privées au début des années 2010 et la concurrence des plateformes, qui ont poussé les producteurs à proposer des genres variés, s’éloignant des «séries comiques assez courtes ou des drames un peu soap opera», analyse l’actrice. «On prend les sujets plus frontalement», abonde son compatriote Yahia Mouzahem, réalisateur d’«El Dama» («Eddama»), carton en 2023. Cette série, qui a fait débat en explorant le trafic de drogue dans Bab el Oued, quartier populaire d’Alger, a notamment été saluée pour son réalisme. «Il n’y a pas de sujets interdits», a assuré le réalisateur lors de la conférence. Mais il faut rester «pudique» et «respectueux» des sensibilités, a-t-il souligné, rappelant que les séries du ramadan rassemblent «toute une famille, du grand-père aux petits-enfants de 5 ans». Par exemple, «il n’y a pas de scène sexuelle, même si la sexualité peut être abordée», relève Malika. On observe la même tendance en Tunisie, où la série la plus populaire cette année est la suite de «Ragouj», créée l’an dernier, qui évoque le despotisme d’un maire et la corruption administrative sous la forme d’une comédie satirique. «Fetna» traite elle des conflits d’héritage dans les familles. Les phosphates, principale richesse du pays, sont au coeur de la série historique «Oued El-Bey» qui relate les mauvais traitements infligés aux ouvriers du bassin minier de la région de Gafsa sous la colonisation française. Fort du succès d’«El Dama» au Maroc, en Tunisie ou encore en Egypte, Yahia Mouzahem a bon espoir de voir les productions algériennes s’exporter davantage, malgré des budgets «très éloignés» de ceux des plateformes, comme le font depuis longtemps les séries égyptiennes. Au-delà des séries du ramadan, l’Algérie est représentée pour la 1ère fois à Séries Mania, avec «El’Sardines» (arte.tv), format court franco-algérien sur l’émancipation d’une trentenaire, réalisé par la poétesse Zoulikha Tahar. L’acteur et producteur français Sofiane Zermani a en outre annoncé monter «une énorme série avec comédiens algériens, réalisateurs algériens et (l’actrice) Lyna Khoudri sur la rédaction de l’organe de presse «Révolution africaine» dans les années 60 et 70 à Alger», à destination d’une plateforme américaine.