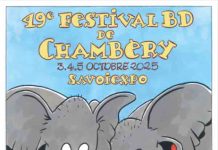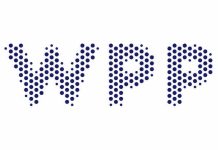France 2 et toute l’équipe de l’unité documentaire de la chaîne étaient présents à la 19ème édition du «Sunny Syde of the Doc», qui s’est tebu la semaine dernière à La Rochelle. L’occasion pour média+ de faire un tour d’horizon de la place du documentaire sur France 2 avec Patricia Boutinard-Rouelle, la Directrice Artistique de l’Unité Magazines et Documentaires.
média+ : Quel bilan faites-vous du documentaire sur France 2 ?
Patricia Boutinard-Rouelle : L’année fut quelque peu agitée pour le Service public! Et pas seulement à cause du 8 janvier et de l’annonce de la suppression de la publicité. En effet, comme vous le savez, les chaînes de la TNT ont transformé le paysage audiovisuel. Mais malgré ces bouleversements, le documentaire se porte très bien sur France 2: la moyenne de part d’audience du documentaire en prime time (18,1% de pda) est supérieure à la part d’audience moyenne de la chaîne. Quant aux parts de marché de deuxième partie de soirée, elles sont en moyenne de 15,3%. Le documentaire semble donc être le genre le plus demandé par le public. Dans les années à venir, il y en aura en conséquence de plus en plus à l’antenne. Notre politique documentaire est axée sur la connaissance, d’où nos prime time sur la science et l’histoire, ainsi que nos deuxièmes parties de soirées avec des collections comme «Infrarouge». Pour rappel, nous avons diffusé plus de 100 heures de documentaires et produit la moitié, sans compter les collections Jeunesses et Culturelles qui représentent 60 heures d’inédits.
média+ : Allez-vous renforcer vos collections de documentaires ?
Patricia Boutinard-Rouelle : Oui, nous allons continuer d’étoffer nos collections car notre budget est en hausse en 2008: il était de 13,8 millions d’euros en 2007, il est à 14,1 millions d’euros en 2008. En 2006, nous avons créé la case du documentaire sur la science ou l’histoire, en prime time. Et depuis, le succès a été fulgurant notamment pour «l’Odyssée de la vie», «La résistance» ou encore «Mitterrand à Vichy». Les documentaires évènements de cette saison seront «Juliette ou l’odyssée de l’amour», une comédie documentaire scientifique ou encore «Les temps changent» un docu-fiction d’anticipation sur l’environnement.
média+: Quelle est la politique de France 2 vis-à-vis de l’international ?
Patricia Boutinard-Rouelle: Depuis trois ans France 2 a développé une ligne éditoriale bien précise: être très présente sur les chaînes étrangères que cela soit en achat ou en coproduction. Nous garantissons des signatures et un certain savoir-faire à nos acheteurs et cela plaît. Nous faisons en sorte que nos programmes aient une dimension internationale, les plus universels étant ceux sur l’histoire et la science. Concrètement, «Versailles, le rêve d’un roi» que la BBC a déjà acheté, est présent dans une quinzaine de pays. C’est également le cas de «Louis XV à Versailles», «Louis XVI» ou les épisodes sur Charlemagne et Henri IV de notre nouvelle collection «En quelques heures tout a changé» pour ce qui est des productions sur l’histoire de France. Sur la science, je citerais pour exemple «Les mystères de la gémellité». Nous réalisons également des documentaires en coproduction, le meilleur exemple étant «Le journal d’Anne Frank», un 100′ réalisé par Jon Jones en coproduction avec Darlow Smithson Productions, BBC et France 2). Mais il faut préciser que lorsqu’on parle de documentaire, c’est pour un projet supérieur à 3 millions d’euros, notre participation moyenne oscillant entre 600 000 et 1,7 million d’euros (1,7 million est notre maximum pour la collection «En quelques heures tout a changé»).
média+ : Faites-vous de la docu-fiction ?
Patricia Boutinard-Rouelle : Oui, cela nous arrive. Notre plus bel exemple étant justement «Le journal d’Anne Frank» qui est un évènement car c’est la première fois que les droits de l’?uvre littéraire sont consentis. Mais cette collaboration entre les unités fiction et documentaire est vraiment inédite car il ne faut pas que les deux unités se confondent. D’ailleurs, cette fiction sur Anne Frank sera suivie d’un documentaire plus traditionnel sur le parcours de l’oeuvre depuis la guerre. En général, il est possible que le documentaire emprunte à la fiction une forme d’écriture. Mais un docu-fiction reste avant tout un documentaire. Le genre peut en effet revêtir de multiples formes: on peut ajouter à un documentaire classique, une écriture issue de la fiction, des archives, de l’humour etc. C’est très flexible. Il existe une différence fondamentale entre la fiction et le documentaire: le documentaire transmet de la connaissance par de la pédagogie. La fiction c’est du divertissement.
média+ : A votre sens, est-ce que le genre hybride «docu-fictions» existe ?
Docu-drama, docu-fiction, fiction du réel… peu importe le nom! Aujourd’hui, tous les programmes commencent de la même façon: une recherche d’informations, un travail de documentation. La différence se fait dans la façon de mettre en scène et de raconter l’histoire.