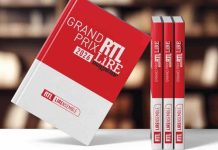Moins de 30% des documentaires diffusés pour la 1ère fois en 2023 à la télévision ont été réalisés exclusivement par des femmes, selon une étude de la Scam, société de droits d’auteurs qui appelle l’ensemble du secteur audiovisuel à «ouvrir enfin les yeux». Entre 2021 et 2023, cette proportion n’a progressé que de deux points, à 28%, quand 55% des documentaires et grands reportages unitaires ont été réalisés par des hommes, pour 17% d’oeuvres «mixtes», selon cette enquête sur l’égalité femmes – hommes dévoilée mercredi. «Quand on reste sous les 30%, moi je considère qu’on peut appeler ça un bastion», a commenté Karine Dusfour, documentariste et administratrice de la Scam, lors d’une conférence de presse. «En 2009, c’était 19%. En 15 ans, ça fait 9 points d’augmentation». A ce rythme, «pour atteindre la parité exacte, il faudra attendre 37 ans, donc en 2062», a-t-elle ironisé. La part d’oeuvres réalisées par des autrices s’avère encore plus faible pour les séries documentaires (13%), tandis que la parité est atteinte pour les reportages (45%). «Faire un documentaire ou un reportage de 5 minutes, ce ne sont pas les même enjeux», a expliqué Karine Dusfour. Or plus les responsabilités et les budgets sont importants, plus les femmes se heurtent à «un plafond de légitimité», constate-t-elle, citant notamment les cas particuliers des documentaires historiques, animaliers et scientifiques, des «grands projets internationaux» souvent réservés aux hommes. Côté diffuseurs, les chaînes de télé enregistrent des «progrès mesurés», selon la Scam. En 2023, M6 et TF1 ont «dépassé la parité», affichant respectivement une proportion de réalisatrices (documentaires, reportages, etc.) diffusées de 54% et 52%, en hausse de trois points par rapport à 2021, contre 42% pour France 2 (-1 point) et 32% pour Canal+, qui stagne à son niveau de 2009, une «inertie» déplorée par la Scam. Autre point d’»alerte» , la moindre visibilité des autrices aux heures de grande écoute, notamment sur France 2. «On a besoin de politiques publiques proactives», a estimé Karine Dusfour, citant le «conditionnement des aides par le CNC», des «engagements forts» et le besoin d’»instances de régulation, de contrôle et de surveillance». «Il y a un travail de fond qu’il faut qu’on fasse nous, de s’adresser (davantage) directement aux diffuseurs», a estimé de son côté Hervé Rony, le DG de la Scam.