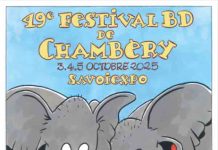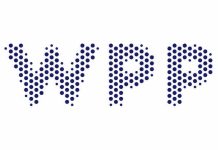Le 18 juin, Christine Albanel, la ministre de la Culture et de la Communication a présenté le projet de loi sur la «Création et Internet». Il vise à apporter des solutions face au piratage des ?uvres sur les réseaux numériques. Retour sur les points forts de la loi.
média+ : Pour quelles raisons écrire ce projet de loi maintenant ?
Christine Albanel : Nous en sommes tous convaincus, l’avenir de la Culture passe par Internet. C’est pourquoi nous devons tout faire pour que le développement des réseaux numériques soit synonyme d’un véritable renouveau. Mais pour qu’Internet puisse devenir un lieu privilégié d’accès aux ?uvres, il ne doit, en aucun cas, constituer une zone de non-droit. La situation la plus grave est celle de l’industrie musicale, avec une chute de 50% en 5 ans de son chiffre d’affaires, une baisse de l’emploi dans les maisons de disques et une diminution d’un tiers du nombre de nouveaux artistes «signés» chaque année. Le cinéma et la télévision commencent à leur tour à ressentir les effets de la crise. Dans notre pays, le piratage revêt une ampleur inégalée, nous sommes dans une situation d’urgence. Le recours à l’offre légale de musique, de films ou d??uvres audiovisuelles en ligne ne représente que 7% du marché contre près de 25% aux Etats-Unis. Le Président de la République, notamment à travers la lettre de mission qu’il m’a adressée le 1er août dernier, s’est particulièrement engagé sur ce dossier.
média+ : Quels sont les points clés de ce texte ?
Christine Albanel : Il y a deux volets à la loi. Premièrement, ce sont les dispositions sur l’amélioration de l’offre légale. Les films sortis en salle seront disponibles sur Internet beaucoup plus rapidement qu’à l?heure actuelle. Les délais seront raccourcis en deux temps. Tout d’abord, dès la mise en place du dispositif anti-piratage, la fenêtre VoD sera ramenée de 7 mois et demi à 6 mois. Ensuite, la chronologie des médias dans son ensemble fera l’objet de négociations, destinées à aboutir dans un délai d’un an maximum à un raccourcissement significatif des fenêtres. Dans le cas de la fenêtre VoD par exemple, il conviendra de se rapprocher très sensiblement de la moyenne européenne, qui est d’environ 3 à 4 mois. Deuxième volet: les accords consacrés à la prévention et à la lutte contre le piratage. La lutte contre le piratage va changer complètement de logique: nous la voulons pédagogique et préventive, avec une riposte graduée. Aujourd’hui, l’internaute qui pirate s’expose à une poursuite pénale, sans qu’il soit possible de l’informer des risques qu’il encourt. Deux avertissements précéderont toute sanction à l’encontre de l’internaute. Une fois par mail, une fois par recommandé. Les sanctions encourues par les internautes prendront une forme qui est directement en rapport avec le manquement: il s’agira d’une suspension d’abonnement pour une durée de trois à douze mois. Dans le cas des entreprises, pour lesquelles la suspension d’Internet aurait des effets excessifs, l’employeur sera invité à installer des «pare-feux» empêchant le piratage par les salariés à partir des postes de l’entreprise. La mise en place de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur l’Internet (Hadopi), chargée de mettre en place le nouveau système, est prévue pour le 1er janvier 2009. Son budget est de 15 millions d?euros.
média+ : Quels sont les résultats espérés ?
Christine Albanel : Lorsqu’il a été mis en ?uvre à l’étranger (par exemple sur certains réseaux câblés aux Etats-Unis), ce système a permis de mettre fin à 90% des téléchargements illicites chez les personnes «averties» à deux reprises (et 97% après trois avertissements). Il ne faut pas oublier que la France est «numéro un dans le monde» en matière de téléchargement illégal (1 milliard d’actes de piratage par an). Si on arrive à réduire le piratage de 70% à 80%, ce serait déjà considérable. Notre projet de loi ne constitue pas un «flicage» des internautes mais s’appuie sur une démarche de «responsabilisation».