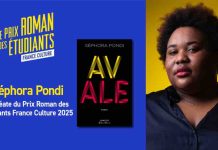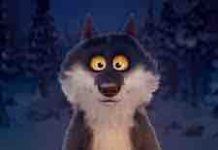Produit revendiqué de «l’exception culturelle» française, qu’elle défend avec fracas, la réalisatrice Justine Triet s’est hissée au sommet du cinéma en quatre films et autant de portraits de femmes. Avec «Anatomie d’une chute», en salles mercredi, elle est la 3ème réalisatrice de l’histoire à décrocher une Palme d’Or à Cannes. A 45 ans, la cinéaste devient après Julia Ducournau («Titane», Palme d’Or 2021), Audrey Diwan («L’évènement», Lion d’Or 2021) ou Alice Diop (Grand Prix du Jury 2022 à Venise avec «Saint-Omer»), l’étendard d’un nouveau cinéma d’auteur français porté par des réalisatrices, qui s’impose dans les plus grands festivals. A Cannes, plutôt que de triompher, Justine Triet met les pieds dans le plat et profite de la tribune pour croiser le fer avec le gouvernement français, en pleine réforme des retraites. L’occasion surtout de défendre le cinéma indépendant face au libéralisme qui le menacerait de toutes part et sans se soucier de ceux qui moquent un milieu vu comme privilégié et biberonné aux subventions. Sans l’exception culturelle, «je ne serais pas là aujourd’hui», lâche-t-elle en recevant la Palme, dénonçant la volonté supposée du pouvoir de «casser» ce modèle. «Il y a un glissement lent vers l’idée qu’on doit penser à (la) rentabilité des films», qui pèserait sur les petites productions, a-t-elle explicité par la suite. «Ingrat et injuste» pour la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak, «enfant gâtée et si conformiste» se moque le maire LR de Cannes David Lisnard, quand le leader de LFI Jean-Luc Mélenchon applaudit le symbole d’une «gauche résistante»… Justine Triet, qui a toujours été passionnée par les luttes et les moments de tension sociale, devient en cette fin mai une figure clivante, loin de l’artiste chaleureuse, cash et qui reçoit sans chichis, casquette sur la tête, autour de la table de la cuisine de son appartement parisien. Née le 17 juillet 1978 à Fécamp (Seine-Maritime), la cinéaste grandit dans la capitale : «Ma mère a eu une vie assez complexe, travaillait et élevait trois enfants, dont deux n’étaient pas les siens. Mon père était très absent», raconte-t-elle. A 20 ans, elle entre aux Beaux-Arts de Paris avec la volonté de devenir peintre. Elle se consacrera finalement à la vidéo et au montage. Un premier documentaire sur les manifestations étudiantes contre le Contrat premier embauche (CPE), en 2007, puis un premier long métrage «La bataille de Solférino», qui fait sensation à Cannes en 2013, alors qu’il était programmé dans une sélection parallèle du Festival. Cette «dramédie» avec Laetitia Dosch et Vincent Macaigne, tournée en pleine foule le jour du second tour de la présidentielle française, était nommée aux César 2014 dans la catégorie du meilleur film. Consommatrice assidue de séries, Justine Triet se voit consacrée avec «Victoria» (2016), porté par Virginie Efira en mère célibataire et avocate pénaliste en pleine crise de nerfs. Le film fait 700.000 entrées et est nommé cinq fois aux César 2017, notamment dans les catégories du meilleur film et de la meilleure actrice. Fidèle, elle retrouve Efira en 2019 dans «Sibyl»: l’actrice incarne une romancière reconvertie en psychanalyste et Triet s’entoure de têtes d’affiche comme Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel et Niels Schneider. Le film est en sélection officielle à Cannes. «Justine ne travaille pas comme les autres, elle fait vraiment du cinéma un art du collectif. Ça se fait ensemble, même si à la fin c’est elle qui tranche», décrit sa fidèle productrice, Marie-Ange Luciani. Si Justine Triet se dit «instinctive», son cinéma, qui ne laisse rien au hasard, est très réfléchi, «questionnant beaucoup les rapports entre les hommes et les femmes qui sont au centre de notre vie aujourd’hui». «Je n’ai pas attendu #MeToo pour que la personne qui vit avec moi travaille presque plus que moi avec les enfants à la maison», souligne-t-elle.