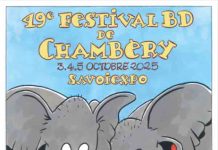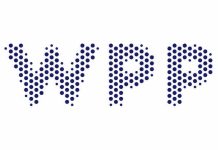À l’occasion de la dernière édition du Festival de Cannes, Mastercard a dévoilé son rapport sur la place des femmes dans le cinéma. L’occasion pour media+ d’évoquer les résultats de l’étude «Women in Film» avec Béatrice CORNACCHIA, Executive Vice-présidente, Marketing et Communications de Mastercard APEMEA.
D’après votre étude, comment les femmes sont-elles représentées dans l’industrie cinématographique en France ?
Notre étude «Women in Film» montre que même si les femmes restent encore sous-représentées dans les postes clés tels que la réalisation, la cinématographie et la production, il existe des signes évidents de progrès et une dynamique croissante en faveur du changement. Les postes de direction et l’accès au financement restent un défi, avec uniquement un peu plus d’une femme sur six impliquée dans la production cinématographique, et encore moins dans les rôles de production ou de stratégie commerciale. Néanmoins, ces questions font l’objet d’une prise de conscience croissante au sein de l’industrie et les professionnels souhaitent vivement créer un environnement plus équitable : plus de 60% des femmes estiment qu’il y a une amélioration s’agissant des opportunités à accéder à des postes de direction.
Ces données sont-elles similaires à celles de nos voisins européens ?
Les tendances que nous avons observées en France se retrouvent sur les autres grands marchés cinématographiques européens. Le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Espagne font par exemple état de défis similaires, notamment un accès limité au financement, moins d’opportunités de mentorat et des obstacles à l’entrée plus importants pour les femmes que pour leurs homologues masculins. Les raisons invoquées par les femmes pour ne pas poursuivre une carrière dans le cinéma, telles que le manque de relations dans le secteur, le manque de confiance en soi et la difficulté à concilier vie familiale et vie professionnelle, se retrouvent sur de nombreux marchés européens.
Les femmes sont-elles optimistes quant à leur avenir dans l’industrie cinématographique ?
Malgré les défis à relever, l’une des conclusions les plus frappantes de l’étude est la résilience et l’optimisme exprimés par les femmes dans l’industrie cinématographique. Un peu plus de 60% des femmes interrogées en France estiment que les opportunités pour les femmes à des postes de direction s’améliorent. Plus impressionnant encore, près de 70% d’entre elles pensent que la prochaine génération de femmes aura un meilleur accès aux opportunités dans l’industrie qu’elles n’ont eu.
Les technologies émergentes transforment-elles l’industrie cinématographique ?
Absolument. Les technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle, la production virtuelle et la distribution numérique sont en train de remodeler tous les aspects de l’industrie cinématographique, de la conception et la création des histoires jusqu’à la manière dont les contenus créatifs sont consommés. Près de la moitié des femmes interrogées (48%) estiment que ces technologies sont une force positive, en particulier en matière de démocratisation de l’accès. Pour les femmes, cette évolution technologique représente une opportunité considérable. Elle leur offre de nouvelles façons d’innover, de raconter des histoires et de prendre le contrôle de leur parcours créatif.
Comment expliquez-vous cette croyance en un avenir meilleur pour les femmes dans l’industrie cinématographique ?
La sensibilisation accrue et le dialogue autour des disparités entre les sexes ont conduit à davantage d’initiatives visant à soutenir les femmes dans le cinéma. Deuxièmement, l’attention culturelle portée à la narration et à la représentation féminines s’est considérablement accrue, créant une demande pour des récits plus diversifiés et plus authentiques que seules les femmes peuvent apporter. Enfin, une nouvelle génération de femmes qui entre dans l’industrie est en train de redessiner le paysage. Elles sont plus connectées grâce aux plateformes numériques, plus enclines à parler de leurs expériences et de leurs droits, et plus déterminées à innover.