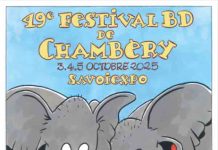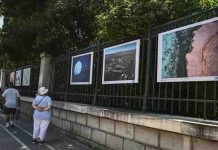La privatisation de TF1 a profondément transformé le paysage audiovisuel français, un univers concurrentiel où la première chaîne domine l’audience depuis 20 ans, face à un pôle public qui résiste assez bien et à une multiplication de l’offre. Quand son acquisition par Bouygues est annoncée le 4 avril 1987, la «Une», qui avait connu des déboires au début des années 1980, a alors retrouvé sa place de leader, grâce au redressement opéré par son président, Hervé Bourges. Le choix du gouvernement de Jacques Chirac de privatiser la chaîne la plus regardée de France donne d’office à cette dernière un avantage considérable. «Le PAF (paysage audiovisuel français) a été déstabilisé: on est passé d’un système à écrasante majorité publique à un système dominé par le privé», résume Philippe Riutort, sociologue des médias. La privatisation déclenche une «course aux animateurs et aux journalistes», initiée par La Cinq, se souvient-il. TF1 parvient ainsi à «débaucher» Michel Drucker, issu du public, qui y fait un bref passage, et à attirer des professionnels de premier plan, comme l’équipe d’Europe 1 menée par Etienne Mougeotte, vice-président de la chaîne. En captant plus de 30% de l’audience, performance inégalée en Europe (même si elle a baissé de 10 points depuis 1989), et 55% du marché publicitaire télévisé, TF1 a imposé son modèle. La faiblesse de la redevance audiovisuelle (l’une des plus petites d’Europe), oblige les chaînes publiques, et principalement France 2, à aller chercher leurs ressources dans la publicité… et à courir, elles aussi, après l’audience. «Il suffit de comparer les journaux télévisés de France 2: dans les années 1980, ils démarrent souvent par l’actualité internationale; aujourd’hui la chaîne se calque sur TF1 et un sujet international fait rarement l’ouverture», observe le sociologue. Dans cette logique privée, les émissions qui ne marchent pas sont souvent déplacées à des heures tardives, et les programmes se veulent le plus «fédérateur» possible. Mais il existe des frontières que le service public s’interdit de franchir, comme la «télé-réalité», lancée par M6 en 2001 avec le «Loft», et largement exploitée par TF1. Si France 3 a trouvé sa place avec une contre-programmation et un ancrage régional, France 2, considérée comme «l’égale» de TF1, a plus de mal, et son audience s’effrite (19,2% en 2006). «C’est dur pour France 2. Pour s’en sortir, elle doit inventer, comme elle l’a fait avec la série des «Maupassant»», un succès d’audience, commente Hervé Bourges, ex-président de France Télévisions. La rumeur récurrente de privatisation d’une des chaînes du groupe France Télévisions (France 2, France 3, France 4, France 5 et France ô) a récemment été démentie par tous les candidats à la présidentielle. Le pôle public reste malgré tout assez puissant dans un PAF relativement équilibré, où «les décalages avec le privé ne sont pas extraordinaires si on compare à nos voisins, comme l’Italie», estime M. Bourges. France Télévisions affichait en 2005 une part d’audience toutes chaînes confondues de 37,6%. Cet équilibre est aujourd’hui menacé par la fragmentation du marché, avec la multiplication des chaînes du câble, du satellite et de la TNT. Les six grandes chaînes hertziennes (TF1, France 2, France 3, Canal+, M6 et Arte) se font progressivement grignoter de l’audience, même si elles ont placé des pions dans les nouvelles chaînes. «Les chaînes historiques devraient néanmoins rester fortes. Mais pour TF1, c’est la fin de la toute puissance: son audience ne pourra plus monter», conclut M. Bourges.
mercredi, juillet 9, 2025
Créer un compte
Bienvenue! s'inscrire pour un compte
Un mot de passe vous sera envoyé par email.
Récupération de mot de passe
Récupérer votre mot de passe
Un mot de passe vous sera envoyé par email.
- Cinéma
- TousCinéma – AccordsCinéma – Aujourd’hui dans le mondeCinéma – CSACinéma – En tournageCinéma – EtudesCinéma – EvènementsCinéma – HommageCinéma – InstitutionnelCinéma – JusticeCinéma – MouvementsCinéma – ParteneriatCinéma – ProgrammesCinéma – RéactionsCinéma – RécompensesCinéma – RésultatsCinéma – SocialCinéma – TechnologieCinéma – Vient de paraitre
- TV
- TousDroits TVTélévision – AccordsTélévision – Actu des chaînesTélévision – Audiences Télévision – Aujourd’hui dans le mondeTélévision – CSATélévision – En tournageTélévision – EtudesTélévision – EvènementsTélévision – FusionTélévision – HommageTélévision – InstitutionnelTélévision – JusticeTélévision – Marchés entreprisesTélévision – MouvementsTélévision – PartenariatsTélévision – ProductionsTélévision – ProgrammesTélévision – ProgrammesTélévision – RéactionsTélévision – RécompensesTélévision – RésultatsTélévision – SocialTélévision – TechnologieTélévision – TNTTélévision – Vient de paraitre
- Production
- TousProduction – AccordsProduction – Aujourd’hui dans le mondeProduction – CSAProduction – EtudesProduction – EvènementsProduction – FusionProduction – InstitutionnelProduction – JusticeProduction – MouvementsProduction – ParteneriatProduction – ProgrammesProduction – RéactionsProduction – RécompensesProduction – RésultatsProduction – TechnologieProduction – Vient de paraitre
- presse
- TousPresse – AccordsPresse – AudiencesPresse – Aujourd’hui dans le mondePresse – EtudesPresse – EvènementsPresse – InstitutionnelPresse – JusticePresse – Marchés entreprisesPresse – MouvementsPresse – PartenariatsPresse – RéactionsPresse – RécompensesPresse – RésultatsPresse – SocialPresse – TechnologiePresse – Vient de paraitrePresse- Programmes
- Radio
- TousRadio – AccordsRadio – AudiencesRadio – Aujourd’hui dans le mondeRadio – CSARadio – EtudesRadio – EvènementsRadio – HommageRadio – InstitutionnelRadio – JusticeRadio – Marchés entreprisesRadio – MouvementsRadio – PartenariatsRadio – ProgrammesRadio – RéactionsRadio – RécompensesRadio – RésultatsRadio – RNTRadio – SocialRadio – TechnologieRadio – Vient de paraitre
- Publicité
- TousPublicité – AccordsPublicité – Aujourd’hui dans le mondePublicité – EtudesPublicité – EvènementsPublicité – FusionPublicité – InstitutionnelPublicité – JusticePublicité – Marchés entreprisesPublicité – MouvementsPublicité – PartenariatsPublicité – RéactionsPublicité – RécompensesPublicité – RésultatsPublicité – SocialPublicité – TechnologiePublicité – Vient de paraitre
- Télécoms
- TousTELECOMMUNICATION-VIENT DE PARAITRETélécommunications – AccordsTélécommunications – Aujourd’hui dans le mondeTélécommunications – EtudesTélécommunications – EvènementsTélécommunications – FusionTélécommunications – InstitutionnelTélécommunications – JusticeTélécommunications – Marchés entreprisesTélécommunications – MouvementsTélécommunications – PartenariatsTélécommunications – RéactionsTélécommunications – RécompensesTélécommunications – RésultatsTélécommunications – SocialTélécommunications – Technologie
- Internet
- TousInternet – AccordsInternet – AudiencesInternet – Aujourd’hui dans le mondeInternet – EtudesInternet – EvènementsInternet – HommageInternet – InstitutionnelInternet – JusticeInternet – Marchés entreprisesInternet – MouvementsInternet – PartenariatsInternet – ProgrammesInternet – RéactionsInternet – RécompensesInternet – RésultatsInternet – SocialInternet – TechnologieInternet – Vient de paraitre
- Interviews
© média+ 2025 - Mentions légales