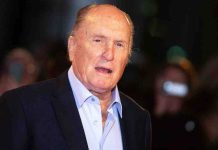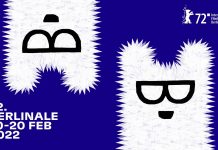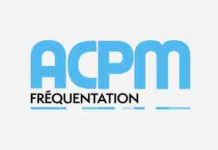Ouvrir les jeux vidéo japonais au public étranger: la «localisation» est devenue une étape cruciale pour les studios nippons qui réalisent l’essentiel de leurs ventes hors-archipel, au point d’influer sur leurs créations pour prendre en compte notamment le mouvement #MeToo. «A l’ère des jeux 8-bits et 16-bits, la localisation, c’était le far west», rappelle l’équipe californienne de Sega derrière l’adaptation anglaise de «Infinite Wealth», dernier opus de la série «Like a Dragon» (anciennement «Yakuza») qui sort vendredi. «Il n’y avait pas de règles, pas de standards, la qualité pouvait varier considérablement. Et ce n’était pas forcément la faute des traducteurs», aux prises avec diverses contraintes techniques et face à un public peu familier avec la culture nippone. Par manque de moyens, de nombreux jeux japonais des années 1980-1990 n’étaient pas traduits, surtout les plus riches en dialogues, ou ce travail était réalisé par les développeurs eux-mêmes dans un anglais parfois approximatif. «Heureusement, l’industrie du jeu et surtout les consommateurs ont beaucoup évolué, et nous sommes désormais en mesure d’être plus fidèles au contenu» original, ajoute l’équipe de Sega of America. Plus qu’une traduction, il faut une adaptation culturelle, souligne Pierre Froget, chef de projet localisation au siège européen de l’éditeur nippon Bandai Namco. «Que le joueur, quel que soit son pays, comprenne et ressente la même chose que celui qui joue dans la langue d’origine». Si Mario, Final Fantasy ou Pokémon ne sont pas inscrits ouvertement dans un environnement japonais, donnant plus de marge pour l’adaptation, la tâche se complique pour des jeux comme les «Yakuza», ancrés dans des quartiers japonais existants, et regorgeant de jargon lié à la pègre nippone. La diffusion de la culture japonaise auprès des publics occidentaux, notamment via les mangas et dessins animés, a cependant facilité le travail de localisation. «On n’a plus besoin d’être aussi pédagogues qu’il y a dix ans», dit Franck Genty, responsable senior de localisation chez Bandai Namco, qui édite les jeux de combat «Tekken», le titre d’action-RPG «Elden Ring» ou les adaptations de Naruto. «Par exemple, les ramens se sont démocratisés (…), on ne va plus dire nouilles» aujourd’hui. Les localisations sont aussi devenues moins caricaturales, comme l’a illustré le changement de nom hors-Japon de la série «Yakuza» baptisée dorénavant «Like a Dragon», plus proche du nom nippon. Et alors que les recettes à l’étranger des développeurs japonais s’étendent, au point de représenter 70% des ventes de cette série, ils prennent davantage en compte les sensibilités étrangères, au point d’adapter leurs contenus. «Beaucoup de représentations courantes au Japon dans les premiers «Like a Dragon» ne sont plus acceptables aujourd’hui», convient Masayoshi Yokoyama, producteur exécutif de la série, citant images caricaturales de la communauté LGBT+ et clichés misogynes. Alors «nous faisons lire les scénarios à nos équipes aux Etats-Unis et en Europe qui nous disent si elles voient des choses qui ne seraient pas acceptées dans leurs pays», explique-t-il. Au siège européen de Bandai Namco, qui supervise l’adaptation de jeux en une dizaine de langues, une question récurrente est «la façon dont les développeurs japonais habillent leurs héroïnes», explique Franck Genty, à la lumière de l’évolution des mentalités et du mouvement #MeToo. «On leur dit là le décolleté est un peu trop décolleté, la jupe un peu trop courte», détaille-t-il. «Avant ils étaient inflexibles mais ils sont devenus davantage proactifs sur ces sujets-là». «On peut aussi avoir des questions de référence à l’alcool, la politique, la religion», énumère Pierre Froget. Ou «quand on a des personnages en bottes noires et grandes gabardines de cuir», qui en Europe rappellent les uniformes nazis. Avec la généralisation des sorties mondiales simultanées des jeux, la localisation doit cependant composer avec des délais toujours plus restreints.
Et malgré des échanges plus fluides avec les développeurs, les convaincre de prendre en compte les contraintes techniques liées aux différentes langues n’est pas toujours aisé. «Ils ont fait l’effort de se tourner vers l’anglais», raconte M. Froget, mais «quand nous en Europe on débarque avec un allemand extrêmement long, ou des questions sur le genre et le nombre on apparaît comme une difficulté supplémentaire».