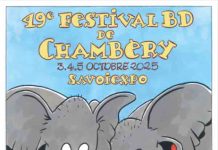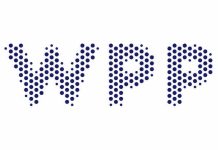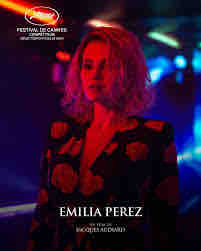A Cannes, la question de la transidentité s’impose cette année comme un leimotiv avec une «normalisation» fulgurante des incarnations trans, notamment portée par l’un des favoris, «Emilia Perez». Dans ce film détonant du Français Jacques Audiard, Manitas, puissant narcotrafiquant mexicain, décide de changer radicalement de vie et de devenir une femme, son aspiration profonde depuis l’enfance. Karla Sofía Gascón, 52 ans, qui tient son premier rôle majeur, a entamé, comme son personnage, sa transition tardivement, à 46 ans. «Cela a été un chemin très difficile», dit l’actrice espagnole, qui rend hommage à sa femme et sa fille qui l’ont soutenue dans cette démarche. Cette transition scelle l’intrigue de départ mais le reste du film s’en affranchit vite, pour parler des liens familiaux, des violences, de la société mexicaine, Emilia devenant une femme engagée et fragile. Audiard saisit la question de ce plus intime des combats avec délicatesse aussi, depuis sa place d’homme cisgenre de 72 ans. «C’est surprenant de voir cette question être saisie par des cinéastes confirmés, souvent «cis» (cisgenre, NDLR) en dehors de la sphère LGBT», relève le journaliste et président-fondateur de la Queer Palm à Cannes, Franck Finance-Madureira. «Mais c’est LA question émergente du combat LGBT depuis une dizaine d’année et il était grand temps d’avoir des personnages-titre trans dans des films, comme dans «Emilia Perez»», ajoute-t-il. De fait, il existe, selon lui, entre trois et quatre réalisateurs et réalisatrices trans dans le circuit du cinéma non indépendant. Notamment les soeurs Wachowski, à l’origine de «Matrix». La question, introduite au grand public par des films marquants, comme «Laurence Anyways» de Xavier Dolan en 2012 et «Girl» de Lukas Dhont en 2018, foisonne aujourd’hui dans les productions. A Cannes, la thématique est au coeur d’une somme notable de films en compétition ou dans d’autres sélections, tels «Transmitzvah» de Daniel Burman, dans lequel Ruben, le fils cadet de la famille Singman, défie les normes en préparant une bat-mitsvah, pendant féminin de la bar-mitzvah. Pour le réalisateur argentin, il est déjà l’heure du dépassement. «Nous devons rendre visibles ces situations mais ne pas s’y laisser enfermer», estime-t-il. Il y a «une focalisation excessive sur l’identité de genre comme seul pilier de l’identité», ajoute Daniel Burman, déplorant un «réductionnisme». Si la plupart des actrices trans (les acteurs trans étant encore peu nombreux) incarnent des rôles de femmes trans, certaines refusent désormais de se laisser enfermer dans cette case. Hunter Schafer, actrice et égérie de la «Gen Z» révélée dans «Euphoria», omniprésente sur le tapis rouge cannois, a déclaré en avril ne plus accepter des rôles queer ou liés à sa transition. «Je crois vraiment que le fait de ne pas en faire la pièce maîtresse de ce que je fais me permettra d’aller plus loin. Et je pense qu’aller plus loin et faire du bon travail, dans l’intérêt du mouvement, sera bien plus utile que d’en parler tout le temps», a balayé la star de 25 ans. Dans «La Belle de Gaza», un documentaire de Yolande Zauberman sur le milieu très fermé des trans palestiniennes réfugiées à Tel-Aviv, la rue et la violence marquent ces «guerrières», selon la réalisatrice, qui reconnait sa fascination pour ces femmes un peu «déesses». Pour Israela, matriarche de la communauté et héroïne du film aux longues nattes blanches, cette éclosion soudaine du cinéma à la question des personnes trans est une évidence de l’époque. «C’est l’humanité qui est en train de faire sa transition, une transition vers une forme d’elle-même plus heureuse parce que plus aimante», avançait, juste avant de monter les marches, cette femme née dans un corps d’homme et dans une famille juive orthodoxe. «La normalisation des personnages gays ou lesbiens a mis 30 ans mais, avec les personnages trans, ça va beaucoup plus vite. Le cinéma est plus apte à prendre le pouls de la société rapidement», abonde le spécialiste Franck Finance-Madureira.
samedi, juillet 12, 2025
Créer un compte
Bienvenue! s'inscrire pour un compte
Un mot de passe vous sera envoyé par email.
Récupération de mot de passe
Récupérer votre mot de passe
Un mot de passe vous sera envoyé par email.
- Cinéma
- TousCinéma – AccordsCinéma – Aujourd’hui dans le mondeCinéma – CSACinéma – En tournageCinéma – EtudesCinéma – EvènementsCinéma – HommageCinéma – InstitutionnelCinéma – JusticeCinéma – MouvementsCinéma – ParteneriatCinéma – ProgrammesCinéma – RéactionsCinéma – RécompensesCinéma – RésultatsCinéma – SocialCinéma – TechnologieCinéma – Vient de paraitre
- TV
- TousDroits TVTélévision – AccordsTélévision – Actu des chaînesTélévision – Audiences Télévision – Aujourd’hui dans le mondeTélévision – CSATélévision – En tournageTélévision – EtudesTélévision – EvènementsTélévision – FusionTélévision – HommageTélévision – InstitutionnelTélévision – JusticeTélévision – Marchés entreprisesTélévision – MouvementsTélévision – PartenariatsTélévision – ProductionsTélévision – ProgrammesTélévision – ProgrammesTélévision – RéactionsTélévision – RécompensesTélévision – RésultatsTélévision – SocialTélévision – TechnologieTélévision – TNTTélévision – Vient de paraitre
- Production
- TousProduction – AccordsProduction – Aujourd’hui dans le mondeProduction – CSAProduction – EtudesProduction – EvènementsProduction – FusionProduction – InstitutionnelProduction – JusticeProduction – MouvementsProduction – ParteneriatProduction – ProgrammesProduction – RéactionsProduction – RécompensesProduction – RésultatsProduction – TechnologieProduction – Vient de paraitre
- presse
- TousPresse – AccordsPresse – AudiencesPresse – Aujourd’hui dans le mondePresse – EtudesPresse – EvènementsPresse – InstitutionnelPresse – JusticePresse – Marchés entreprisesPresse – MouvementsPresse – PartenariatsPresse – RéactionsPresse – RécompensesPresse – RésultatsPresse – SocialPresse – TechnologiePresse – Vient de paraitrePresse- Programmes
- Radio
- TousRadio – AccordsRadio – AudiencesRadio – Aujourd’hui dans le mondeRadio – CSARadio – EtudesRadio – EvènementsRadio – HommageRadio – InstitutionnelRadio – JusticeRadio – Marchés entreprisesRadio – MouvementsRadio – PartenariatsRadio – ProgrammesRadio – RéactionsRadio – RécompensesRadio – RésultatsRadio – RNTRadio – SocialRadio – TechnologieRadio – Vient de paraitre
- Publicité
- TousPublicité – AccordsPublicité – Aujourd’hui dans le mondePublicité – EtudesPublicité – EvènementsPublicité – FusionPublicité – InstitutionnelPublicité – JusticePublicité – Marchés entreprisesPublicité – MouvementsPublicité – PartenariatsPublicité – RéactionsPublicité – RécompensesPublicité – RésultatsPublicité – SocialPublicité – TechnologiePublicité – Vient de paraitre
- Télécoms
- TousTELECOMMUNICATION-VIENT DE PARAITRETélécommunications – AccordsTélécommunications – Aujourd’hui dans le mondeTélécommunications – EtudesTélécommunications – EvènementsTélécommunications – FusionTélécommunications – InstitutionnelTélécommunications – JusticeTélécommunications – Marchés entreprisesTélécommunications – MouvementsTélécommunications – PartenariatsTélécommunications – RéactionsTélécommunications – RécompensesTélécommunications – RésultatsTélécommunications – SocialTélécommunications – Technologie
- Internet
- TousInternet – AccordsInternet – AudiencesInternet – Aujourd’hui dans le mondeInternet – EtudesInternet – EvènementsInternet – HommageInternet – InstitutionnelInternet – JusticeInternet – Marchés entreprisesInternet – MouvementsInternet – PartenariatsInternet – ProgrammesInternet – RéactionsInternet – RécompensesInternet – RésultatsInternet – SocialInternet – TechnologieInternet – Vient de paraitre
- Interviews
© média+ 2025 - Mentions légales