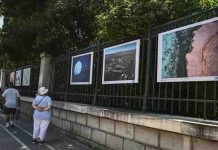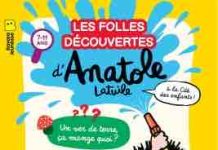Le discrédit d’un réalisateur, accusé de violences sexuelles, doit-il entraîner celui de son film et de toute son équipe ? La sortie mercredi prochain en France de «Je le jure» met en lumière une équation délicate, entre enjeux judiciaires et financiers, qui émerge depuis #Metoo. A l’été 2023, après un pot d’équipe lors du tournage de ce film français, le réalisateur Samuel Theis a été accusé de viol par un technicien. Présumé innocent, il n’a pas été inculpé mais placé sous le statut de témoin assisté, dans le cadre d’une enquête pour viol. Situation inédite pour la production: comment concilier le respect de la parole du plaignant, la présomption d’innocence du réalisateur et la préservation des intérêts économiques en sortant malgré tout le film en salles ? Le tournage a pu se terminer avec un protocole de confinement improvisé du cinéaste sur le plateau. Du jamais vu en France. «Ce protocole nous a permis de prendre acte d’une souffrance (du plaignant, NDLR), tout en terminant le film». «Je le jure» sort en salles accompagné d’un dispositif de «non-mise en lumière» de son réalisateur, qui ne donne pas d’interview. La production pense avoir trouvé l’équilibre: «ces mesures de protection favorisent la libération de la parole des victimes, en leur montrant qu’on ne peut pas les intimider en leur faisant porter le poids de la mort d’un film», fait-elle valoir. «Nous sommes convaincus que le fruit d’un travail collectif ne doit pas être invisibilisé s’il a été accompagné correctement dès le 1er signalement», justifie-t-elle. Au contraire, le dernier film du réalisateur Jacques Doillon, accusé de viol sur mineur par la comédienne Judith Godrèche, quand elle était adolescente, n’est pas sorti. L’actrice Nora Hamzawi, qui tient l’un des rôles principaux, s’est opposée à la diffusion de «CE2». La ministre française de la Culture Rachida Dati s’est dite, pour sa part, «gênée par la sanction collective (…), de punir tout un film en raison d’un comportement inapproprié ou illégal d’une personne». Des petites productions comme «Je le jure» (5 millions d’euros de budget) aux plus grosses, c’est toute l’industrie du cinéma français qui s’adapte à cette nouvelle donne. Sous l’impulsion du CNC, depuis 2021, une assurance permet d’indemniser à hauteur de 500.000 euros 5 jours d’interruption de tournage en cas de signalement de violences au procureur. «Ceux qui pensent que le mieux est de mettre la poussière sous le tapis se trompent lourdement», a estimé le producteur star Dimitri Rassam («Le Prénom», «Monte-Cristo», «Les Trois mousquetaires»), mi-mars, devant la commission d’enquête de l’AN sur les violences dans le cinéma. «Désormais, c’est la gestion du risque juridique, économique et d’image qui prime, et c’est vertueux», a-t-il poursuivi, expliquant que les grosses productions ont tout intérêt à éviter harcèlement ou agressions sur leurs plateaux. Et les producteurs réfléchissent maintenant à 2 fois avant de lancer un projet avec des réalisateurs ou acteurs dont ils redoutent le comportement: «c’est notre responsabilité économique et commerciale de prendre en compte tout ça quand on décide de faire un film», avec «des millions d’euros en jeu», a plaidé le patron du géant du cinéma français Pathé Films, Ardavan Safaee, l’un des hommes les plus puissants du cinéma français. Jamais confronté à un signalement d’agression sexuelle, Hugo Sélignac, producteur de «L’Amour ouf», a raconté avoir eu à gérer des problèmes de «violences psychologiques»: «il m’est arrivé de dire «on serre les fesses», le tournage est bientôt fini», mais cette époque est désormais révolue, précise-t-il. De nombreuses productions affirment enfin avoir renoncé aux fêtes de tournage, alcoolisées, propices aux agressions. «Nos métiers étaient réputés festifs, ça a largement diminué», a témoigné à l’Assemblée le producteur François Kraus, qui veut «limiter les risques».
jeudi, juillet 3, 2025
Créer un compte
Bienvenue! s'inscrire pour un compte
Un mot de passe vous sera envoyé par email.
Récupération de mot de passe
Récupérer votre mot de passe
Un mot de passe vous sera envoyé par email.
- Cinéma
- TousCinéma – AccordsCinéma – Aujourd’hui dans le mondeCinéma – CSACinéma – En tournageCinéma – EtudesCinéma – EvènementsCinéma – HommageCinéma – InstitutionnelCinéma – JusticeCinéma – MouvementsCinéma – ParteneriatCinéma – ProgrammesCinéma – RéactionsCinéma – RécompensesCinéma – RésultatsCinéma – SocialCinéma – TechnologieCinéma – Vient de paraitre
- TV
- TousDroits TVTélévision – AccordsTélévision – Actu des chaînesTélévision – Audiences Télévision – Aujourd’hui dans le mondeTélévision – CSATélévision – En tournageTélévision – EtudesTélévision – EvènementsTélévision – FusionTélévision – HommageTélévision – InstitutionnelTélévision – JusticeTélévision – Marchés entreprisesTélévision – MouvementsTélévision – PartenariatsTélévision – ProductionsTélévision – ProgrammesTélévision – ProgrammesTélévision – RéactionsTélévision – RécompensesTélévision – RésultatsTélévision – SocialTélévision – TechnologieTélévision – TNTTélévision – Vient de paraitre
- Production
- TousProduction – AccordsProduction – Aujourd’hui dans le mondeProduction – CSAProduction – EtudesProduction – EvènementsProduction – FusionProduction – InstitutionnelProduction – JusticeProduction – MouvementsProduction – ParteneriatProduction – ProgrammesProduction – RéactionsProduction – RécompensesProduction – RésultatsProduction – TechnologieProduction – Vient de paraitre
- presse
- TousPresse – AccordsPresse – AudiencesPresse – Aujourd’hui dans le mondePresse – EtudesPresse – EvènementsPresse – InstitutionnelPresse – JusticePresse – Marchés entreprisesPresse – MouvementsPresse – PartenariatsPresse – RéactionsPresse – RécompensesPresse – RésultatsPresse – SocialPresse – TechnologiePresse – Vient de paraitrePresse- Programmes
- Radio
- TousRadio – AccordsRadio – AudiencesRadio – Aujourd’hui dans le mondeRadio – CSARadio – EtudesRadio – EvènementsRadio – HommageRadio – InstitutionnelRadio – JusticeRadio – Marchés entreprisesRadio – MouvementsRadio – PartenariatsRadio – ProgrammesRadio – RéactionsRadio – RécompensesRadio – RésultatsRadio – RNTRadio – SocialRadio – TechnologieRadio – Vient de paraitre
- Publicité
- TousPublicité – AccordsPublicité – Aujourd’hui dans le mondePublicité – EtudesPublicité – EvènementsPublicité – FusionPublicité – InstitutionnelPublicité – JusticePublicité – Marchés entreprisesPublicité – MouvementsPublicité – PartenariatsPublicité – RéactionsPublicité – RécompensesPublicité – RésultatsPublicité – SocialPublicité – TechnologiePublicité – Vient de paraitre
- Télécoms
- TousTELECOMMUNICATION-VIENT DE PARAITRETélécommunications – AccordsTélécommunications – Aujourd’hui dans le mondeTélécommunications – EtudesTélécommunications – EvènementsTélécommunications – FusionTélécommunications – InstitutionnelTélécommunications – JusticeTélécommunications – Marchés entreprisesTélécommunications – MouvementsTélécommunications – PartenariatsTélécommunications – RéactionsTélécommunications – RécompensesTélécommunications – RésultatsTélécommunications – SocialTélécommunications – Technologie
- Internet
- TousInternet – AccordsInternet – AudiencesInternet – Aujourd’hui dans le mondeInternet – EtudesInternet – EvènementsInternet – HommageInternet – InstitutionnelInternet – JusticeInternet – Marchés entreprisesInternet – MouvementsInternet – PartenariatsInternet – ProgrammesInternet – RéactionsInternet – RécompensesInternet – RésultatsInternet – SocialInternet – TechnologieInternet – Vient de paraitre
- Interviews
© média+ 2025 - Mentions légales