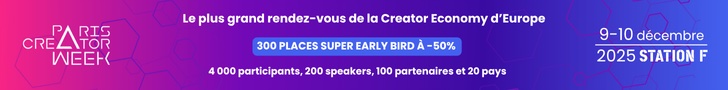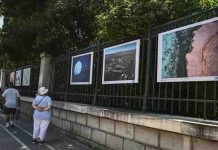L’enquête de Monica Baro sur des cas de saturnisme à La Havane lui a valu un prestigieux prix latino-américain de journalisme. Mais le site pour lequel elle écrit est bloqué à Cuba, où le gouvernement voit d’un oeil suspect les médias indépendants. Deux ans sur le terrain, six mois de fact-checking: derrière la publication de son article sur le site Periodismo de Barrio, une course de longue haleine. «Dans un contexte moins hostile, cette enquête aurait peut-être pu être faite, rédigée et vérifiée en un an, mais ici tout est beaucoup plus compliqué», explique la reporter de 31 ans, sur le canapé de son appartement havanais qui lui sert aussi de bureau. Quand elle a entendu parler, en 2016, d’intoxication au plomb dans le quartier populaire de San Miguel del Padron, Monica Baro est allée rencontrer les habitants. Beaucoup avaient peur, les informations étaient rares, confuses. La plupart des sources officielles refusaient de lui parler. Pour internet, elle devait se connecter au wifi public à 2 dollars de l’heure. Et toujours cette possibilité d’être suivie, harcelée, menacée. Dans ce pays classé 168e sur 180 pour la liberté de la presse par Reporters sans Frontières (RSF), le journalisme indépendant est illégal aux yeux de l’Etat même s’il est toléré, du bout des lèvres. Les efforts de la journaliste, qui travaille désormais pour un autre site, ont payé: elle a reçu en octobre à Bogota un prix Gabo (Gabriel Garcia Marquez), l’un des plus reconnus du continent. Diffusés exclusivement en ligne, les médias indépendants cubains brillent à l’étranger depuis quelques années: en 2017 un prix Gabo pour El Estornudo, en 2018 un prix espagnol dans l’environnement pour Periodismo de Barrio, en 2019 un prix du journalisme en ligne pour El Toque. Mais à quel prix. Le 16 janvier, le directeur d’un portail officiel d’informations a publié sur internet une liste de 21 médias non officiels, dénoncés comme des «plateformes pour le rétablissement du capitalisme à Cuba». Deux jours plus tard, plusieurs de ces sites étaient temporairement inaccessibles sur l’île. Certains étaient déjà bloqués de façon permanente. Le gouvernement socialiste les assimile au journalisme d’opposition, pratiqué par des sites généralement gérés depuis Miami, et les accuse d’être financés par le gouvernement américain. La fameuse liste des 21 mélangeait les deux genres. «Les médias indépendants n’existent pas, ni à Cuba ni, je crois, nulle part dans le monde», affirme le journaliste de l’hebdomadaire officiel Trabajadores Francisco Rodriguez Cruz, 49 ans. Ce sont des «médias dépendants de l’extérieur» dont «très souvent (la) vision trop biaisée ne privilégie que les éléments critiques de la réalité cubaine», poursuit-il. «C’est facile (…) dans une société comme la nôtre, sous embargo du gouvernement américain (depuis 1962, NDLR) et avec de multiples difficultés économiques». Nés pour la plupart lors de la détente entre Cuba et les Etats-Unis (2014-2016) et portés par l’arrivée de l’internet mobile fin 2018, ces nouveaux médias ont pour ambition affichée de trouver une troisième voie, dépouillée de toute idéologie, entre presse d’Etat et d’opposition. Ils ont profité de la courte ouverture pour oeuvrer plus librement. Financés, selon les cas, par une fondation suédoise, des ambassades européennes (Norvège, Pays-Bas, etc), une ONG britannique, une radio néerlandaise, ils comptent dans leurs rédactions une dizaine de jeunes reporters passés par les mêmes bancs de l’université de journalisme que leurs camarades entrés dans les médias d’Etat. Un choix assumé. Si leur salaire peut être 3 à 4 fois supérieur – ce qui leur vaut des critiques -, ils dépendent de l’arrivée des fonds étrangers, souvent vivent modestement, en travaillant chez eux avec leur propre matériel, sans certitude sur l’avenir de leur publication.
lundi, juillet 7, 2025
Créer un compte
Bienvenue! s'inscrire pour un compte
Un mot de passe vous sera envoyé par email.
Récupération de mot de passe
Récupérer votre mot de passe
Un mot de passe vous sera envoyé par email.
- Cinéma
- TousCinéma – AccordsCinéma – Aujourd’hui dans le mondeCinéma – CSACinéma – En tournageCinéma – EtudesCinéma – EvènementsCinéma – HommageCinéma – InstitutionnelCinéma – JusticeCinéma – MouvementsCinéma – ParteneriatCinéma – ProgrammesCinéma – RéactionsCinéma – RécompensesCinéma – RésultatsCinéma – SocialCinéma – TechnologieCinéma – Vient de paraitre
- TV
- TousDroits TVTélévision – AccordsTélévision – Actu des chaînesTélévision – Audiences Télévision – Aujourd’hui dans le mondeTélévision – CSATélévision – En tournageTélévision – EtudesTélévision – EvènementsTélévision – FusionTélévision – HommageTélévision – InstitutionnelTélévision – JusticeTélévision – Marchés entreprisesTélévision – MouvementsTélévision – PartenariatsTélévision – ProductionsTélévision – ProgrammesTélévision – ProgrammesTélévision – RéactionsTélévision – RécompensesTélévision – RésultatsTélévision – SocialTélévision – TechnologieTélévision – TNTTélévision – Vient de paraitre
- Production
- TousProduction – AccordsProduction – Aujourd’hui dans le mondeProduction – CSAProduction – EtudesProduction – EvènementsProduction – FusionProduction – InstitutionnelProduction – JusticeProduction – MouvementsProduction – ParteneriatProduction – ProgrammesProduction – RéactionsProduction – RécompensesProduction – RésultatsProduction – TechnologieProduction – Vient de paraitre
- presse
- TousPresse – AccordsPresse – AudiencesPresse – Aujourd’hui dans le mondePresse – EtudesPresse – EvènementsPresse – InstitutionnelPresse – JusticePresse – Marchés entreprisesPresse – MouvementsPresse – PartenariatsPresse – RéactionsPresse – RécompensesPresse – RésultatsPresse – SocialPresse – TechnologiePresse – Vient de paraitrePresse- Programmes
- Radio
- TousRadio – AccordsRadio – AudiencesRadio – Aujourd’hui dans le mondeRadio – CSARadio – EtudesRadio – EvènementsRadio – HommageRadio – InstitutionnelRadio – JusticeRadio – Marchés entreprisesRadio – MouvementsRadio – PartenariatsRadio – ProgrammesRadio – RéactionsRadio – RécompensesRadio – RésultatsRadio – RNTRadio – SocialRadio – TechnologieRadio – Vient de paraitre
- Publicité
- TousPublicité – AccordsPublicité – Aujourd’hui dans le mondePublicité – EtudesPublicité – EvènementsPublicité – FusionPublicité – InstitutionnelPublicité – JusticePublicité – Marchés entreprisesPublicité – MouvementsPublicité – PartenariatsPublicité – RéactionsPublicité – RécompensesPublicité – RésultatsPublicité – SocialPublicité – TechnologiePublicité – Vient de paraitre
- Télécoms
- TousTELECOMMUNICATION-VIENT DE PARAITRETélécommunications – AccordsTélécommunications – Aujourd’hui dans le mondeTélécommunications – EtudesTélécommunications – EvènementsTélécommunications – FusionTélécommunications – InstitutionnelTélécommunications – JusticeTélécommunications – Marchés entreprisesTélécommunications – MouvementsTélécommunications – PartenariatsTélécommunications – RéactionsTélécommunications – RécompensesTélécommunications – RésultatsTélécommunications – SocialTélécommunications – Technologie
- Internet
- TousInternet – AccordsInternet – AudiencesInternet – Aujourd’hui dans le mondeInternet – EtudesInternet – EvènementsInternet – HommageInternet – InstitutionnelInternet – JusticeInternet – Marchés entreprisesInternet – MouvementsInternet – PartenariatsInternet – ProgrammesInternet – RéactionsInternet – RécompensesInternet – RésultatsInternet – SocialInternet – TechnologieInternet – Vient de paraitre
- Interviews
© média+ 2025 - Mentions légales