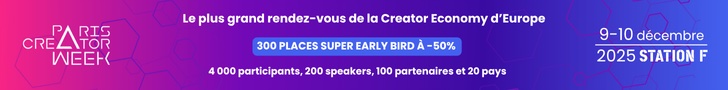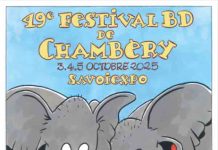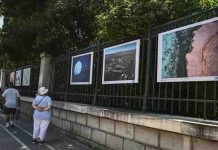Mercredi 13 décembre, le Parlement Européen a adopté le texte révisant la directive «télévision sans frontière». Celle-ci a notamment réduit la durée minimale entre deux spots de publicité, passant de 45 à 30 minutes. Jean-Marie Cavada nous confie son avis sur le texte dans son ensemble.
média+ : La réforme de la directive « télévision sans frontière » était-elle indispensable ?
Jean-Marie Cavada : Le texte de compromis est acceptable compte tenu de la pression qui s’est exercée sur Viviane Reding, la commissaire désignée à la Société de l’information et aux Médias. La Commission et le Parlement Européen ont trouvé un juste milieu et même un coup de frein à la poussée libérale. Les opérateurs privés voulaient libéraliser largement la publicité et le placement de produits. Ils réclamaient aussi l’absence de règles sur les nouveaux médias. De mon point de vue, ces demandes étaient tout à fait dangereuses et menaçaient de dénaturer beaucoup les écrans. La Commission a pris en considération l’avis des «restrictifs» comme moi qui ne voulaient pas qu’on lâche le cheval à bride abattue. Si les télévisions publiques avaient emporté le morceau et si leur lobbying avait été plus fort, l’orbite privé se serait plaint. D’ailleurs, certains groupes privés ont considéré que le texte était timide, ce qui est le signe qu’on a trouvé un avis médian. Seulement on a fait un petit pas libéral.
média+ : Etes-vous satisfait de la place accordée au service public par la directive ?
Jean-Marie Cavada : À ma grande surprise, la mission de l’audiovisuel publique a été présente dans les débats, mais pas suffisamment dans la décision. Il n’y a pas de recommandation concernant le financement des radios et télévisions publiques sur le moyen terme dans ce sens. Leur existence est laissée au bon vouloir des Etats. En France, en Italie, en Espagne, les budgets sont déterminés d’une année sur l’autre. Une chaîne publique allemande connaît son budget sur les 4 ans à venir. Le «braodcasting act» anglais prévoit un financement de la BBC sur 10 ans. Quand je dirigeais des médias, j’ai toujours vu que les problèmes entre le privé et le public n’étaient jugés qu’à l’aune de la concurrence commerciale. Mais personne ne s’est occupé de savoir si les chaînes privées faussaient la concurrence de l’audiovisuel public. Il faut préserver la diversité des contenus quel que soit le support, internet, la TNT.
média+ : Ce texte est-il satisfaisant ?
Jean-Marie Cavada : Ce texte suffira pour quelques années, mais je doute qu’il puisse aller beaucoup plus loin. Je pense qu’il faudra le réviser. Il faudra notamment vérifier l’état de santé des systèmes publics de télévision. Mais cette directive est moins pire que ce que je craignais. Il y avait un gros risque. Lors de la conférence de Liverpool en 2004, la poussée des entreprises commerciales était énorme. Les Français étaient d’ailleurs les plus timides. Il faut voir ce qu’est un privé allemand ou britannique : Médiaset de Berlusconi, News Corp de Rupert Murdoch. Les grands groupes privés vivent aujourd’hui sous la menace de se faire racheter par un groupe de télécoms. Aussi, veulent-ils consolider leur bilan, gagner de l’argent le plus vite possible pour pouvoir se défendre. Le moindre groupe de télécommunication européen a 8 à 10 fois plus de cash qu’un groupe de télévision privée. Ils ont acheté des droits sportifs pour avoir le but à but. Ils vont diffuser des films sur les mobiles. L’ogre télécommunication attend que la loi les autorise à racheter. Mais, ça ne nous concerne pas. C’est une bataille entre eux. Nous devons défendre l’équilibre public-privé.