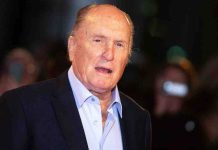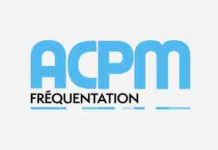La fronde sans précédent des radios et télévisions sanctionnées après leur couverture des attentats parisiens par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) réactive la contestation du rôle du gendarme de l’audiovisuel à l’heure d’internet et des réseaux sociaux.
Créé par la loi du 17 janvier 1989, le CSA est une autorité administrative indépendante qui vérifie la bonne application de la loi du 30 septembre 1986. Cette dernière porte notamment sur «la rigueur dans le traitement de l’information», «l’attribution des fréquences aux opérateurs de télévision et de radio» ou «le respect de la dignité de la personne humaine». «Même si elle a été modifié plusieurs fois, c’est une loi qui est totalement obsolète!», estime l’historien de la presse Patrick Eveno. «Le CSA ne tient ses prérogatives que du fait qu’il attribue les fréquences pour les radios et les télévisions», rappelle-t-il. «Il peut aller jusqu’à retirer l’autorisation d’émettre. C’est une arme atomique qu’il n’a jamais employé». Le plus souvent, le CSA admoneste les radios et les télévisions, avec la menace d’amendes ou d’autres sanctions en cas de récidive, comme après les prises d’otage de janvier à paris. Après avoir analysé 500 heures de programmes, l’institution a adressé à 16 médias 36 avertissements pour avoir, pendant leurs directs, révélé des informations sensibles, susceptibles de mettre en péril la vie des otages. Mercredi, dans une lettre ouverte, la quinzaine de radios et télévisions tancées par le CSA ont estimé que l’information était «menacée» par ces sanctions. Parmi les arguments mis en avant, le «deux poids, deux mesures» entre l’audiovisuel, régulé par le CSA, et les autres: journaux, internet et les réseaux sociaux. Or, le CSA, qui dit n’avoir fait qu’appliquer la loi, ne peut pas intervenir sur les journaux et leur émanation sur internet, qui dépendent, eux, de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Depuis son arrivée en janvier 2013, le président du CSA Olivier Schrameck, plaide à longueur de rapport et d’intervention pour un élargissement des attributions de l’institution. Si elle dit ne pas vouloir être le «gendarme de l’internet», la haute autorité souhaiterait se pencher sur les services audiovisuels numériques, tels que YouTube et Dailymotion, sur la base du volontariat et d’une autorégulation, à travers des chartes et des labels. Dans ce but, Olivier Schrameck tente à la tête de l’ERGA, le groupe des régulateurs européens de l’audiovisuel, de coordonner la réponse aux nouvelles plates-formes de diffusion comme Netflix. Isabelle Wekstein, avocat spécialisé dans le droit de la presse, ne voit pas «ce que le CSA fera de plus la prochaine fois. Il n’y a pas lieu de renforcer ses pouvoirs», estime-t-elle. «Le problème général est plus celui des auteurs de propos racistes ou antisémites, d’incitation à la haine raciale sur le net où l’anonymat favorise la libération de la parole et une absence totale de responsabilité sans possibilité d’appliquer les textes répressifs qui existent et sont suffisamment bien rédigés» pour la presse, ajoute-t-elle. Elle plaide plutôt pour des mesures techniques plus efficaces afin de limiter l’accès à certains contenus et d’identifier les auteurs.
De son côté, Fabrice Lorvo, autre avocat dans le droit des médias, se dit «choqué» par la réaction des radios et télévisions, qu’il estime «disproportionnée». «Il y a une vision de l’information en continu qui consiste à tout montrer tout de suite. Je pense que cela peut être dangereux notamment lorsque cela perturbe le travail de la police(…)», insiste Me Lorvo. «Même s’ils doivent être responsables, le rôle des médias n’est pas de sauvegarder l’ordre public, c’est de raconter la vraie vie!», rétorque l’historien Patrick Eveno.